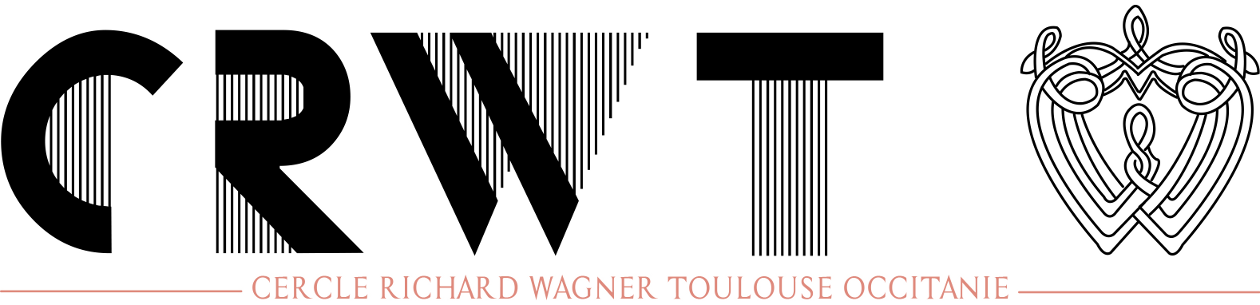Irène Theorin est née en Suède à Gislaved. Bien qu’ayant toujours aimé la musique, elle a commencé tard sa carrière, après son troisième enfant. Très tôt elle a été mère : « je suis devenue une mère presque comme une adolescente».
Irène Theorin est née en Suède à Gislaved. Bien qu’ayant toujours aimé la musique, elle a commencé tard sa carrière, après son troisième enfant. Très tôt elle a été mère : « je suis devenue une mère presque comme une adolescente».
Elle a exercé bien d’autres activités avant de se consacrer au chant. Ce n’est qu’à la chorale de l’université qu’elle a pris conscience de ses possibilités vocales. Elle rejoignit alors l’Opéra Studio de Copenhague. Elle ne le quittera qu’en 2014, y ayant acquis une solide formation vocale. Ses premiers rôles au sein de cette compagnie furent Freia, Donna Anna, Pamina, une des dames de La flûte enchantée. En parallèle elle fut l’élève de Geoffrey Parsons, avec lequel elle travailla longtemps le Lied.
Irene Theorin entourée par quatre membres du Cercle Richard Wagner de Toulouse à Barcelone : de gauche à droite Anne-Elizabeth Agrech, Annie Lasbistes, Cristiane Blemont et Anne-Marie Boubenes

Elle ne fut pas vraiment l’élève de Birgit Nilsson, avec elle, elle suivit seulement un master class en Angleterre. D’elle, elle tient une constante vigilance concernant la technique vocale. C’est une perpétuelle remise en question lui enseigna-t-elle, puisque le chant est vécu comme un mouvement de bascule, quelque chose de difficile paraît subitement facile et vice versa. Birgit Nilsson est un point de repère pour elle. Elle a beaucoup écouté ses enregistrements. Son admiration se traduit par ce que personne, depuis Nilsson, n’a pu chanter comme elle chantait, et de lui être comparée est un grand honneur. Le 6 août 2008 la voilà en Isolde à Bayreuth. C’est le point de départ d’une immense carrière internationale. Elle est au Métropolitan en Brünnhilde en 2009, 2012-2013 pour un Ring au StaatOper de Berlin, à la Scala de Milan, à Bayreuth, à Budapest, à Barcelone, en 2014. Ces toutes dernières années elle s’est illustrée dans les rôles de Turandot et d’Elektra. Elle vient de chanter La femme sans ombre à Berlin et est annoncée au Liceu de Barcelone de la fin novembre au 15 décembre. Elle est devenue essentielle dans les rôles d’Isolde et de Brünnhilde à Bayreuth ces dernières années. Dans les nombreuses interviews qu’elle donne, elle évoque beaucoup l’acoustique, la technique vocale, propres à Bayreuth. Une des qualités remarquable de la scène bayreuthienne, dit-elle, est que le chanteur s’entend chanter où qu’il soit sur la scène, en dépit de la puissance de l’orchestre. Car l’orchestre peut parfois jouer incroyablement fort, et il faut alors faire attention, dit-elle, et ne pas trop se dépenser soi-même. Car chanter trop fort est la pire des choses qui puisse arriver à un chanteur. Il appartient alors au chef d’apaiser l’orchestre quand cela arrive.
Mais ce rôle du chef n’est pas des plus aisés. Irène Theorin remarque qu’il dépend de ses assistants. Et en effet que l’orchestre soit placé sous la scène crée des difficultés certaines pour le chef d’orchestre, que Christian Thielemann explique en détail dans son livre Mein Leben mit Richard Wagner : « Bien sûr la fosse peut être capricieuse. (…) deux exemples : si je suis sur la chaire pensant que le chœur et l’orchestre fonctionnent merveilleusement entre eux, il est sûr que c’est l’inverse qui est en train de se produire dans l’auditorium ; le chœur est venu trop tôt, pas beaucoup plus tôt, juste un peu, mais quand même. Ou quand la chanteuse Brünnhilde dans le Crépuscule est embarquée dans ses passages ultimes, j’ai à lire les paroles par lesquelles elle appelle pour la construction du bûcher funéraire sur ses lèvres, parce que je ne peux réellement l’entendre elle, l’orchestre couvrant sa voix.
En effet, la seule place où il faut être à Bayreuth, c’est dans la salle, là seulement les éléments individuels se mêlent. En un mot nous les interprètes nous perdons nos fonctions ; les oreilles à l’orchestre entendent au mieux un aigu ou un cri lointain venant des chanteurs. Les chanteurs quant à eux trouvent difficile de s’entendre les uns les autres, et le chef peut voir tout le monde et toutes choses mais ne peut se fier à ses oreilles. ‘’A Bayreuth, dit Daniel Barenboim, il n’est pas permis au chef d’entendre la musique.’’ » La leçon qu’en tire Thielemann, c’est que la qualité musicale de Bayreuth tient à ce que ces handicaps se transmuent en avantages par l’étroite collaboration entre artistes, techniciens, personnel de toutes fonctions « Tout le monde est important » dit Thielemann. C’est dans ce contexte qu’Irène Theorin réfléchit sur les difficultés que représentent ses rôles d’Isolde et Brünnhilde.
Ce qui est frappant chez elle c’est que la valeur musicale de son chant est l’aboutissement d’une analyse scrupuleuse de sa technique vocale. Le chant semble être, avec elle, le résultat d’une énergie corporelle, d’un ancrage dans l’anatomie, l’expression d’une force vitale. « Il est nécessaire, confie-t-elle dans l’interview accordée à wagneropera.net, de développer votre énergie prudemment avec des rôles aussi lourds ». Elle doit trouver à quel moment utiliser sa force physique et vocale, et ne jamais l’utiliser au-delà de 80%. Mais durant la représentation, elle évite de penser à ce qui va arriver dans dix minutes ou à la fin de l’acte. Elle ne suit pas les conseils que d’autres chanteuses ont pu lui donner, qui consistent à apprendre un Acte et faire suivre cet apprentissage par une version de concert, et ensuite se lancer dans l’interprétation sur une scène d’opéra. Sa méthode est d’étudier le rôle dans un temps très court, et d’aller de l’avant.( Lorsqu’elle chanta Isolde à Bruxelles, elle avait fait peu de représentations auparavant, le rôle était encore tout frais, mais elle y fut extraordinaire). « Avec des rôles comme Isolde ou Brünnhilde, dit-elle, vous ne pouvez pas rester à répéter dans une pièce et chanter pour vous-même. Vous devez le faire réellement, sur scène, en représentation. »
Elle est très consciente aussi des spécificités propres aux rôles de Brünnhilde et Isolde. Brünnhilde laisse plus de temps pour développer les émotions. Il y a chez elle (dans la Walkyrie) une grande flambée dès les premières minutes, et puis cela retombe et laisse le temps d’extérioriser tout le registre avec ironie, chaleur, amour et tristesse. Isolde contient plus de bel canto que Brünnhilde, plus de longues lignes vocales. Tout le Liebestod est une longue expression d’amour, ‘’Mild und Leise’’ est très introspectif et rempli d’émotion. Des fortissimos apparaissent aussi à certains endroits. La force de la voix est autre chose que la puissance, chanter trop fort aboutit à quelque chose de froid.
La scène finale de Brünnhilde demande plus d’expression physique. D’ailleurs, dit-elle, Brünnhilde est un rôle différent à chaque opéra. Dans La Walkyrie après le premier ‘’Hojotoho’’ Brünnhilde est plutôt dans le registre d’une mezzo, alors que Brünnhilde dans Siegfried s’élève très haut, dans le Crépuscule nous avons une combinaison des deux. Avec Brünnhilde on sort de scène plus souvent. Alors qu’Isolde est en scène pour la plus grande partie des deux premiers actes. Vous n’avez pas le temps de vous retourner et de sucer une pastille.
A la question : Qu’est-ce qui fait que le Liebestod soit quelque chose d’aussi grand ? Irène Theorin semble un peu déconcertée. C’est une question difficile, dit-elle, et elle ne sait si elle peut y répondre. Ce qui en fait la grandeur, peut-être, c’est que vous ne pouvez qu’aller de l’avant et ce n’est pas une seule phrase, bien que toutes les parties sont profondément liées entre elles … Une des raisons possible pour laquelle le Liebestod a un si grand impact est que cette musique a déjà été présente dans tout l’opéra et c’est une sorte de reprise finale magnifique. « Dans la musicalité du travail, pendant que j’en fais l’expérience ici (Bayreuth) sur scène, avec le chef et l’orchestre une dimension suprême s’achève. Le chef, Peter Schneider, fait quelque chose ici que je n’avais jamais expérimenté avant. Nommément il garde tout le Liebestod au même tempo. (Traditionnellement, vous poussez un peu plus au milieu et cela devient plus passionné). Il dit lui-même qu’il n’est jamais allé sur ce chemin auparavant, mais a senti subitement que c’est la route à suivre parce qu’il n’y a plus un alignement d’émotions mais seulement une simple, grande émotion. Et j’ai suivi jusqu’au bout. Nous n’en avions pas convenu auparavant, c’est arrivé pendant la première répétition.»
Il est indéniable qu’Irène Theorin est du côté de ‘’la grande santé’’ nietzschéenne, de la volonté de puissance. A Bayreuth, en 2000, elle obtient un premier contrat pour chanter Ortlinde, elle chantera le rôle jusqu’en 2005 puis ce sera Helmwige, à la suite d’une défection, elle dut apprendre le rôle en une nuit, puis se furent Sieglinde, Isolde, Brünnhilde, et maintenant Elecktra et Turandot, comme si une grande énergie féminine ne cessait de croître. On comprend ainsi qu’elle soit foncièrement en faveur du regietheatre, elle dit avoir beaucoup ri à la mise en scène des Meistersinger de Katharina Wagner, elle l’a trouvée divertissante, elle défend la représentation d’Isolde que Marthalers lui fit jouer, ainsi que la Brünnhilde de Cassiers. Ce qui la séduit c’est le caractère explosif de ces tentatives. Mais elle semble indifférente à la prétention intellectuelle de ces démarches. La légèreté de ses remarques à propos de Marthalers le montre : « C’est très intellectuel et très intelligent et fait avec goût (on la voit quand même attifée de la pire des manières et notamment d’une gabardine au moment du Liebestod, que l’on retrouvera d’ailleurs à la fin du Crépuscule de Carsen). Il donne de la nourriture à la pensée. Les gens discutent vraiment à son sujet. Mon opinion est que si une mise en scène crée débat, et bien c’est un succès.» C’est bien quand même ce que l’on entend à chaque fois en matière de justification.
Sans doute que le modèle de critique édifiante se trouve dans le compte-rendu du Ring de Cassiers de la Scala de Milan, dans le Blog du Wanderer du mois de mai 2013. En sélectionnant des passages isolés de l’ensemble de la critique sans doute s’opère une orientation particulière qui trahit la cohésion de la démarche, mais il n’en demeure pas moins que cette sélection révèle un principe général : la vérité de l’humanité ne réside que dans la mise en évidence de la corruption, de la violence et de la mort. Le Ring de Richard Wagner en est le faire valoir. Il est écrit ceci : « Götterdämmerung pose un regard qui rappelle celui de Rheingold qui va boucler la boucle, c’est le point final de la construction d’un univers qui est d’abord esthétique, qui pose l’art d’aujourd’hui comme outil pour indiquer la déliquescence du monde qui nous entoure. Il est très clair que sans références artistiques et esthétiques, sans percevoir l’idée que cette lecture part d’abord d’une vision esthétique du monde et part de l’œuvre d’art dans ce qu’elle peut avoir de plus incisif, avoir (sic) subversif, on passe à côté en pensant avoir affaire à un travail d’une vacuité totale. Il faut connaître Jef Lambeaux ou Damien Hirst. »
Damien Hirst débuta sa carrière par une œuvre intitulée ‘’A Thousand Years’’ (1990), un grand aquarium contenant une boîte d’asticots, un attrape-mouches électronique et une tête de vache en décomposition sur laquelle les mouches survivantes pondent de nouveaux œufs. Damien Hirst se singularise en choisissant comme moyen d’expression privilégié des animaux morts ou vifs. Nous sommes désormais sommés de connaître l’œuvre de Damien Hirst avant de nous rendre à une représentation du Ring. Continuons : « Ainsi ce Crépuscule qui va d’abord dire la violence, avec dans les vidéos ces corps tordus, dont on distingue les formes avec peine, distendus, torturés, ces visages effrayés, ces bouches béantes, qui apparaissent de temps à autre dans les vidéos, avec le feu, la mort et le sang omniprésents (…) Cassiers dit un peu la même chose que Kriegenburg à Munich (…) : Krigenburg inscrit le Götterdämmerung dans notre monde, le monde crépusculaire de l’après Fukushima ou celui décadent des Gibichungen noyés dans la perversion et le sexe. Cassiers mythifie la ruine du monde perverti par la mort, la violence et le sang.» Et plus loin : « La scène finale justement, à la fois grandiose et dérisoire, mais (sic) l’idée de faire tomber des cintres la sculpture monumentale de Jeff Lambeaux Les passions humaines, l’inscrivant dans le cadre de scène comme elle l’est au pavillon Horta à Bruxelles. Dominée par la mort au sommet le relief représente les légions perdues d’hommes et de femmes dénudées représentant la mort, le suicide, la guerre, le Christ en croix, c’est-à-dire une sorte de vision générique du monde perdu par ses passions, c’est-à-dire ce que Götterdämmerung peut pressentir d’un monde complètement livré à ses instincts sans plus aucune régulation.» L’enthousiasme pour cette production du Ring se conclut par l’éloge de l’interprétation d’Irène Theorin en Brünnhilde.
Une vision très noire du Ring peut être soutenue, mais on ne voit pas très bien la raison d’en faire le prétexte à une représentation apocalyptique du monde contemporain. Que peu de choses soient comme nous le souhaiterions, est un fait, d’en conclure que le pire nous menace n’est pas une conclusion rationnelle. La réalité est suffisamment ouverte pour toujours laisser une raison d’espérer. Il y a dans ce type de mise en scène une contradiction flagrante. Le concept d’esthétique est sans cesse mis en avant, ou plutôt est la caution par laquelle on va justifier des messages de prophètes de malheur. L’esthétique est le domaine d’appréciation qui nous permet de juger les choses en termes de beau et de laid, elle relève du sentiment, en aucun cas elle ne peut s’autoriser à véhiculer des considérations relevant de positions politiques. Or, c’est bien l’axe qui anime les intentions de bien des metteurs en scène actuels. Ils sont victimes du gauchisme généralisé à la mode, qui comme tout gauchisme, est pourfendeur de la Loi en place et imaginant une sorte de monde idéal à l’absolu opposé de tout ce qui existe présentement (l’on aurait d’ailleurs bien du mal à donner une représentation tangible de cet absolu, comme de tout absolu, par définition). C’est ce dont fait preuve Robert Carsen dans son interprétation du Crépuscule au Liceu de Barcelone. Il en fait une dénonciation écologique, sociale et politique du monde actuel, il montre : ‘’des politiciens ballots, qui dépourvus d’ambition, se retrouvent pris au piège de leurs promesses non tenues qui les entraînent dans leur propre perte, détruisant au passage la nature elle-même ‘’ Bloc du Wanderer. La leçon de ces mises en scène revient à dire que tout ce que nous vivons maintenant est le résultat de forces malignes et oppressives qu’il font dénoncer de toute urgence, quitte, au nom justement de cette urgence, d’utiliser les œuvres d’art universellement établies, telles que les œuvres de Wagner.
Cette volonté insistante à vouloir avilir le présent conduit à confondre la Terre avec l’Uranus de Marcel Aymé : « Malheureuse planète ! Astre sombre roulant aux marches de l’infini, ton destin n’est plus une promesse et s’écrit en quelques formules mathématiques. A ton firmament froid, le soleil n’est qu’un point et jamais sa lueur ne dissipe les ténèbres où tu poursuis ta course de géant aveugle. Uranus, ton nom est trompeur, car tu ne connais pas la douceur d’un ciel. Tu ne connais pas non plus la joie d’une eau vive, le mystère d’une eau profonde et ta solitude obscure ne se reflète pas au miroir de la vie.»
Christian Thielemann fait remarquer à propos de Wagner : « Ce n’est pas pour rien qu’aucune fin de sa musique dramatique n’est en mode mineur. Toutes se finissent en majeur, même Tristan, même Le Crépuscule des dieux. » Il ne faut pas confondre création et volonté de néantisation, Wagner est un créateur, non un fossoyeur.
« Et Dieu dit : Que la terre produise de l’herbe, des plantes qui donnent des graines, et des arbres qui donnent des fruits selon leur espèce et qui ont eux-mêmes leurs graines. Et cela fut. Alors les prés offrirent la verte fraîcheur pour le plaisir des yeux. Le spectacle gracieux est relevé de la suave parure des fleurs. Ici s’exhale l’odeur des plantes balsamiques, là grandissent celles qui guérissent les plaies. Le rameau ploie sous la charge des fruits dorés ; le bocage se courbe en une fraîche voûte, une épaisse forêt couronne l’abrupte montagne. Alors les prés offrirent la verte fraîcheur…» Haydn donne sa voix à l’ange Gabriel, mais qu’elle idée aurions-nous de Gabriel s’il ne s’incarnait pas dans la voix d’Elisabeth Grümmer? Et que seraient Elisabeth, Elsa, Eva, sans elle?

Certains artistes, par la qualité exceptionnelle du timbre, la maîtrise et la puissance du souffle, les nuances de couleurs, la justesse musicale, portent les rôles qu’ils incarnent dans des dimensions insoupçonnées et inouïes. Ce n’est qu’après l’expérience de telles voix, que nous prenons conscience de toute la vérité spinozienne voulant que tout ce qui est précieux ne peut être trouvé sans grande peine, et, pour cette raison, presque tous le négligent.
Elisabeth Grümmer appartient à ces êtres qui nous font prendre conscience combien nous avons été négligents avant de les rencontrer. En un mot, elle incarne la beauté du chant à son incandescence, et transcende les opéras wagnériens dès lors qu’elle y est présente. Et dans le même mouvement elle nous apporte la joie de savoir que ces opéras poursuivent leur chemin vers une Beauté non encore accomplie. Il nous suffit d’attendre la nouvelle Elisabeth Grümmer, le nouveau Furtwängler ou le nouvel Wieland Wagner.
Qui mieux qu’elle peut rendre la sagesse et la noblesse du « Zurük von ihm!… Ecartez –vous de lui… » du deuxième acte de Tannhäuser? Qui serait capable de faire du « Allmächt’ge Jungfrau, hör mein Flehen! Vierge toute puissante, écoute ma prière», du troisième acte, une prière suffisamment crédible pour faire accepter le miracle d’une branche morte se mettant à bourgeonner?
Le premier air du deuxième acte, le : « Dich, teure Halle, grüss’ich wieder, … Salle aimée, je te salue à nouveau … » dès le do à l’octave du commencement, est animé d’un vibrato qui résonne comme un écho dans l’immense salle des troubadours. Quand Grümmer arrive à la fin, au « Du teure Halle, sei mir gegrüsst …O salle aimée, je te salue » le sei mir gegrüsst, répété plusieurs fois, soudain ne vibre plus, et est une pure joie exprimée, en même temps comme un abîme qui s’ouvre, à cause du timbre à peine voilé, une tristesse sans limites apparaît. Mille choses semblables seraient à relever dans tout son art du chant, chez l’Eva des Meistersinger, chez l’Elsa de Lohengrin, chez l’Agathe du Freischütz, dans les lieder de Schubert qu’elle interprète. Le sens de la conjugaison du mot et de la note est ce qui découvre le don d’une grande artiste ou d’un grand artiste. C’est une excellence, on peut beaucoup aimer le chant de ceux qui n’y atteignent pas, mais il ne faut jamais, jamais oublier que cette excellence existe.
La carrière d’Elisabeth Grümmer débuta en 1941-1942. Elle resta au Städtische Oper de Berlin (devenu le Deutsche Oper) durant seize ans. Elle chanta cinq saisons à Bayreuth, à partir de 1958. Elle eut également une grande carrière internationale.
Elle vécut, elle, l’apocalypse autrement que sous forme de carton-pâte : elle fut prise sous les bombes des avions alliés tombant sur les villes allemandes. Son mari, premier violon d’un orchestre, fut tué dans sa cave lors d’un de ces bombardements. Elisabeth Grümmer était encore une jeune femme, elle ne s’est jamais remariée.
Irène Theorin aussi bien que Christian Thielemann signalent la présence dans la fosse de Bayreuth, d’un vieux téléphone gris avec une petite lumière rouge, que le chef utilise pour communiquer avec ses assistants. Si le ciel m’avait accordé les dons nécessaires pour diriger à Bayreuth, je n’aurais jamais pu utiliser ce téléphone sans m’attendre plus ou oins à entendre la voix d’Elisabeth Grümmer, venant de l’au-delà et me disant des paroles que seul un ange peut connaître.
Michel Olivié