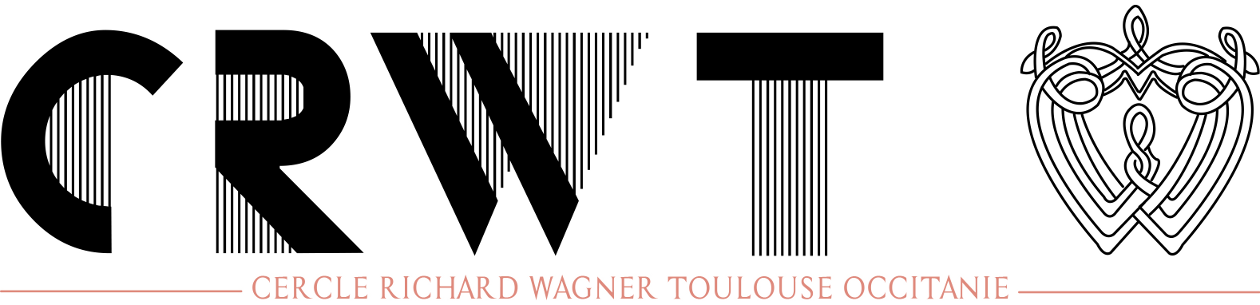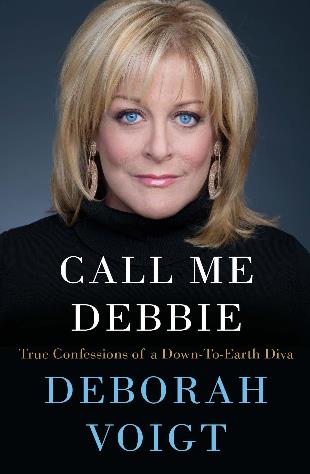 Le récit autobiographique suppose de la part de celui qui l’écrit l’intention d’installer le lecteur dans le mode de la vérité, de la confidence et de la confiance. Le Rousseau des Confessions nous en prévient : « Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même.» Mais l’autobiographie suppose un écart entre le moment évoqué et le moment de la confidence, l’auteur ne fait son récit qu’à la condition d’être sorti indemne des péripéties qu’il relate, il écrit avec du recul. Si bien que là où il voudrait la réalité de la vie est produite à la place la vérité de la fiction romancée. Ces remarques me sont inspirées à partir de la lecture du livre de la grande soprano lyrique américaine Deborah Voigt paru sous le titre Call me Debbie, en janvier 2015, non encore traduit en français. Elle retrace sa vie de personne et sa carrière lyrique dans le but suivant : « Aucun de nous n’est parfait, nous sommes seulement humains, comme Jimmy (James Levine) a l’habitude de me le dire pour me rassurer. Et il est important de dévoiler et de partager notre humanité avec chacun. C’est la raison principale pour laquelle j’ai écrit ce livre. » Le propos peut paraitre assez court, mais la démarche qu’elle développe dans le livre en fait d’humanité est loin d’être quelque chose de convenu.
Le récit autobiographique suppose de la part de celui qui l’écrit l’intention d’installer le lecteur dans le mode de la vérité, de la confidence et de la confiance. Le Rousseau des Confessions nous en prévient : « Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même.» Mais l’autobiographie suppose un écart entre le moment évoqué et le moment de la confidence, l’auteur ne fait son récit qu’à la condition d’être sorti indemne des péripéties qu’il relate, il écrit avec du recul. Si bien que là où il voudrait la réalité de la vie est produite à la place la vérité de la fiction romancée. Ces remarques me sont inspirées à partir de la lecture du livre de la grande soprano lyrique américaine Deborah Voigt paru sous le titre Call me Debbie, en janvier 2015, non encore traduit en français. Elle retrace sa vie de personne et sa carrière lyrique dans le but suivant : « Aucun de nous n’est parfait, nous sommes seulement humains, comme Jimmy (James Levine) a l’habitude de me le dire pour me rassurer. Et il est important de dévoiler et de partager notre humanité avec chacun. C’est la raison principale pour laquelle j’ai écrit ce livre. » Le propos peut paraitre assez court, mais la démarche qu’elle développe dans le livre en fait d’humanité est loin d’être quelque chose de convenu.
Deborah Voigt est née et a grandi au sein d’une conventionnelle famille baptiste américaine. Son enfance, son adolescence, ses études sont semblables à ce que l’on suppose d’une famille américaine moyenne. Le récit qu’elle fait de ces débuts ne présente en soi rien de bien notable. Ce ne sera que lorsqu’elle sera plus tard confrontée à ses impasses existentielles que des souvenirs d’enfance demanderont à y être reliés.
Il y a en effet deux évènements inscrits comme scènes initiales de l’enfance mentionnés par Deborah Voigt, la première relative à son obésité, relate un élan compulsif irrésistible, elle avait alors autour de six ans. Un jour où les parents étaient absents, elle se précipita sur un bocal d’olives vertes dont elle avala tout le contenu, jusqu’à l’eau restée au fond. Ses parents, en revenant, la trouvèrent malade, le père se mit dans une violente colère, essentiellement parce qu’elle avait menti à la baby-sitter, en lui soutenant que ses parents l’autorisaient à manger les olives du bocal. Le plus grave étant que cette baby-sitter appartenait à leur église. La seconde scène initiale concerne également le père, et est à mettre en relation avec le sentiment d’inadéquation de Deborah Voigt avec son art. Vers l’âge de treize ans, alors qu’elle était passionnée de musique (religieuse ou plutôt de variété) son professeur de musique, Miss Cronin lui dit qu’elle avait une voix et un talent spéciaux et qu’elle devait persévérer. Elle remporta un concours de chant local – le premier de sa vie – et se mit à rêver d’une carrière musicale. Se trouvant un jour seule dans la maison, elle se mit au piano installé dans le living-room, et laissa aller sa voix et ses sentiments, imaginant qu’elle chantait jusqu’aux derniers rangs du balcon d’une salle de Broadway saisie par une sorte de transcendance. Soudain, elle entendit le pas lourd de son père montant l’escalier. Elle se glaça et tintèrent à ses oreilles les paroles de ses parents : « ne te mets pas en avant, ne sois pas orgueilleuse … » Le père marcha vivement vers Deborah et son piano et lui dit en colère : « Pour qui te prends-tu ? » Elle se sentit humiliée et honteuse. Elle pensa quelle avait fait quelque chose de mauvais, de faux, que son goût pour le chant avait quelque chose d’immoral et de contraire à la religion. Durant des mois après cet incident elle se sentit intérieurement malade. Ce qui l’empêcha de se soumettre à l’autoritarisme du père, elle le met en avant au tout début du livre : cela se passa au petit matin de 1974, elle venait de se réveiller et était « toute au silence de ce début de journée, semblable à un moment de musique rare et beau. » La lumière filtrait au travers des rideaux de la chambre, elle était bien au chaud sous les couvertures, regardant à demi-endormie les premiers rayons de soleil se glisser sur les murs couleur citron de la chambre. « C’est à ce moment que je L’entendis, une voix qui venait de partout et de nulle part. La voix était aussi claire que le jour ; à la fois forte comme un lion et douce comme un murmure. Il dit cinq simples mots, mais ils furent suffisamment forts pour m’indiquer le chemin que je devrais suivre à partir de ce moment et à l’avenir : Tu es ici pour chanter (you are here to sing). »
Déborah Voigt reste persuadée jusqu’à aujourd’hui de la réalité totalement palpable de cet évènement. Au cours des nombreuses interviews qu’elle a données depuis la parution de son livre sur les chaînes de télévisions américaines elle réaffirme le caractère concret de ce fait. L’autobiographie retraçant à la fois la carrière lyrique et le parcours psychologique suppose en filigrane ces souvenirs d’enfance et la totale incompatibilité entre l’interdit du père terrestre et l’injonction du père éternel.
Nous sommes environ quarante ans après ces scènes d’enfance. Deborah Voigt est devenue une chanteuse lyrique de dimension internationale et de premier plan. Elle a le Métropolitan de New York comme scène principale, et par sa volonté, puisqu’elle se veut avant tout cantatrice cent pour cent américaine. Elle a chanté à Vienne, à Paris, à Londres, en Russie, en Chine, les plus grands rôles de Richard Strauss, Puccini, Verdi avec les plus grands partenaires : Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann. Elle vient, enfin, de chanter Brünnhilde dans le Ring de New York. Et pourtant nous la retrouvons, dans l’avant dernier chapitre, le dix-septième, sur le siège arrière de la voiture de son père et de sa belle-mère, décapsulant les bouteilles d’un pack de quatre cannettes de vin blanc, en route pour un centre de désintoxication. Son alcoolisme était devenu tel que ses plus proches assistantes Jesslyn Cleary et Jaime s’en alarmaient véritablement : « Debbie, lui dit Jaime, tu ne peux pas continuer à vivre cette double vie. Deborah Voigt la star d’opéra sur scène et hors scène … une ivrogne incontrôlable. »
Au commencement du dernier chapitre elle est toujours sur le siège arrière de la voiture de son père conduisant « sa gentille petite paroissienne en désintoxication. Qu’est-ce que l’église allait en penser ? » Sa pensée imbibée par l’alcool ne pouvait s’empêcher d’aller vers Wotan et Brünnhilde, cette histoire entre un père et sa fille. « Wotan n’est pas commode, et il la punit, elle, sa fille favorite, lorsqu’elle ne lui a plus obéi. A la demande de Brünnhilde, Wotan a fait surgir un feu magique pour l’entourer et la protéger, afin de tenir à distance tous les hommes, à l’exception du plus brave. C’est ce que j’ai toujours ardemment désiré, adolescente, que mon père soit un gardien pour moi et mon protecteur, et non celui dont j’avais peur. Dans le même sens je désirais un Dieu d’amour et de pardon, et non un dieu qui juge et qui punit. Mon père est en train d’essayer de m’aider maintenant, je le sais. »
A la première thérapie de groupe dans laquelle elle fut intégrée, elle se présenta de la façon suivante : « Salut, Je suis Debbie. Je suis addicte à la nourriture, à l’alcool, et aux hommes. » Le groupe : « Hiiiii, Debbieeeeeeeee ! »
Deborah Voigt était obèse depuis l’âge de dix-sept ans. Cette obésité était liée à l’idée qu’il était presque de règle pour une cantatrice d’avoir du poids, mais sa carrière se trouva confrontée à cette question de façon récurrente, relativement aux rôles féminins qu’elle était amenée à jouer, elle l’aborde avec pragmatisme : « Comment une femme de trois cents livres peut jouer le rôle d’Aida si les spectateurs ne croient pas que le ténor puisse la trouver attractive ? » Elle ne perdait pas pour autant du poids, tout au contraire, elle était sans cesse portée vers ce qui se mange. Bientôt s’installa un constant et douloureux combat pour maigrir, un souci permanent quant à son poids et à l’image qu’elle renvoyait aux autres. Mais pour autant elle assumait ce qu’elle était lorsqu’il le fallait, c’est-à-dire confrontée à l’injustice ou à la méchanceté du milieu professionnel. Ainsi l’anecdote de la ‘’petite robe noire’’ qui dépassa le cadre du seul milieu musical. Deborah Voigt était programmée pour chanter Ariane à Naxos au Covent Garden, dans une nouvelle mise en scène d’approche très «moderne». La direction jugea que Deborah Voigt était trop grosse pour le rôle qui présupposait le port d’une petite robe noire. Une telle raison de rupture de contrat était passible d’une action en justice, Deborah n’en fit rien, mais finit, plus tard, par en parler à un journaliste et l’histoire fit le tour de la planète. Mais aussi l’incroyable question de Georg Solti après qu’elle eut auditionnée pour lui dans le rôle d’Isolde dans la perspective d’un enregistrement à venir : « Ce fut merveilleux », dit-il en souriant, «vous pouvez être une grande Isolde… mais pourquoi êtes-vous si grosse, c’est la nourriture ? » –« Et bien Maître, c’est la nourriture, oui, mais d’autres choses aussi bien ». Il n’en resta pas là, quelques mois plus tard elle le revit pour s’entendre dire : « Si vous perdez du poids de maintenant jusqu’à ce que je vous convoque pour la neuvième de Beethoven, vous pourriez avoir le boulot.» Son poids tournait donc à une perpétuelle souffrance, trouvant tout de même injuste que la réprobation dont elle était l’objet toucha moins ou pas du tout les chanteurs comme Ben Heppner ou Luciano Pavarotti, qui, lorsqu’ils chantaient en duo n’hésitait pas à se placer en arrière de la scène afin de paraître moins imposant qu’elle.
En juillet 2004 elle se décida pour une intervention chirurgicale, un pontage gastrique. Après son opération beaucoup de choses changèrent. Se regardant dans le miroir elle se voyait disparue. « Ou peut-être, dit-elle cruellement, était-ce la vraie Debbie qui émergeait au-dessous des couches d’années de douloureux repas.» Sur le plan du chant aussi il y eut de nécessaires adaptations. Elle éprouvait quelque chose d’étrange, comme si elle n’était plus reliée à son corps. Grosse, son poids fournissait une assise pour la musculature engagée dans le chant dont elle se trouva privée une fois revenue à une stature normale. Bien évidemment les critiques trouvèrent qu’à cause de ce changement sa voix s’était modifiée à son désavantage. Elle explique avec bon sens que n’importe comment la voix d’une cantatrice change comme le temps passant nous fait changer, et si sa voix sonne différemment aujourd’hui cela aussi est dû au changement de son répertoire. Venant des arias de spinto soprano de Tosca ou Aida elle accède aux rôles plus lourds d’Isolde ou Brünnhilde. Ce rôle de Brünnhilde elle pouvait maintenant l’aborder en lui rendant plus de justice qu’elle ne l’aurait fait auparavant. Ses accents sont très sévères par rapport à elle-même dans le jugement rétrospectif de son apparence : son visage, ses expressions ne se perdent plus dans une boule indistincte. Un simple geste de son bras peut être clairement compris du public puisque quarante livres de graisse ne pendent plus de lui. Pourtant, se croyant délivrée le plus douloureux est devant elle.

Se mêlent dans le drame qui arrive Brünnhilde, Jason son nouvel amoureux, et l’alcool. Elle était consciente depuis longtemps que la nourriture et l’alcool avaient une fonction anesthésiante, qu’ils la ‘’sortaient d’elle-même’’. Dans un passage du livre, elle identifie avec précision ce dont souffre son existence : « J’ai toujours senti avec les hommes qu’ils étaient froids et distants, dans la retenue, injoignables… indisponibles. Et si je m’en rendais compte je finissais par solliciter et plaider pour l’attention dont j’avais besoin. Et si je n’y parvenais pas, je tombais dans l’excès de nourriture ou d’alcool pour remplir ce vide que je ressentais, c’était le mode habituel. » Il n’est pas surprenant alors que le désir inextinguible d’amour, du manger et du boire soit ce qui prend toute la place dans sa vie, mais en totale séparation avec sa vocation de chanteuse d’opéra. Elle réussissait à maintenir la séparation, jusqu’au moment où cela ne fut plus possible.
Etrangement, en 2010, en été, elle est heureuse. Elle n’est plus obèse, elle ne boit plus, elle est débarrassée de ses deux précédents amants qui lui faisaient une vie impossible, et en 2011 elle est à nouveau amoureuse, amoureuse d’un choriste du Métropolitan. Elle va enfin chanter Brünnhilde, au Canada, qu’elle considère comme le rôle de sa vie. Elle parle de ce rôle en wagnérienne accomplie : « C’est un voyage par étapes qui vous conduit jusqu’à elle. Il vous faut avoir chanté beaucoup de Toscas, de Minnies, d’Arianes, de Chrysothemises auparavant. Et, si vous avez de la chance, ces rôles vous conduisent à cette magnifique et téméraire Walkyrie. Ma voix était mûre pour cela et mon corps amaigri était aux bonnes proportions.» Cette première fut un succès. Elle eut une excellente critique de la part du New York Times. Le chroniqueur avait prédit, dix ans auparavant, lorsqu’elle avait interprété Sieglinde, qu’elle promettait d’être une Brünnhilde majeure, ce qui n’a pas manqué de se réaliser. Au mois de mai 2011 elle reprend le rôle de Brünnhilde au Métropolitan, qu’elle assura jusqu’en février 2012 avec le Crépuscule. Elle était entourée d’Eva-Maria Westbrock, Stephanie Blythe, Bryn Terfel, Jonas Kaufmann, Hans Peter König. La direction d’orchestre revenait à James Levine, la mise en scène à Robert Lepage. Ce fut une production magnifique. Mais Deborah Voigt était à nouveau totalement dévastée.
Jason, le choriste du Metropolitan ne s’était pas mieux comporté que les autres et lui avait finalement préféré une chanteuse du chœur. Voici ce qui peut se passer dans la tête d’une cantatrice après deux cycles du Ring : « Je marchais sur la scène pour mon dernier salut et le public sauta sur ses pieds applaudissant et acclamant, envoyant un tsunami d’amour dont j’avais tellement besoin, et qui m’inonda. Je ressentais … tout. J’étais soulagée, après deux années, d’avoir atteint la fin du parcours de Brünnhilde, et fière d’avoir achevé deux cycles du Ring en dépit de la partie de moi-même qui aurait pu tout détruire. » Les idées se bousculaient dans sa tête. Elle avait peur. Peur que ce soit le dernier tombé de rideau comme Brünnhilde au Met. Peur de jeune fille réalisant qu’elle était pour la dernière fois en scène avec Jason dans le chœur Götterdämmmerung. La scénographie du Götterdämmerung veut que Hagen demande à certains de ses hommes de prêter serment de fidélité à Brünnhilde, parmi les choristes qui s’approchèrent de Deborah était Jason. Arrivée à la scène finale Brünnhilde, prête à se jeter dans le bucher et rejoindre Siegfried, se confondait avec Debbie voyant flamber le bucher de son histoire d’amour avec Jason. « Sur scène toutes ces émotions jaillirent à gros bouillons et je me consumais en larmes. Puis, je rentrais chez moi et bus, ne sachant comment me sortir de toutes ces sentiments ou quoi faire avec cette sensation accablante de fin.»
La cure de désintoxication la ramena à une certaine sérénité. Elle retrouva son seul compagnon constant, son petit chien Steinway. Elle abandonne progressivement la scène de l’opéra pour se consacrer à l’enseignement du chant, et participe volontiers aux activités du Mormon Tabernacle Choir comme soliste. On ne peut qu’être bouleversé par les confessions qu’elle développe dans son ouvrage, car il ne s’agit pas de l’étalage d’une intimité morbide mais de l’élaboration d’un véritable mal-être existentiel. Ce sont les confidences de Debbie qui nous sont proposées, mais l’on souhaiterait lui dire : toute notre gratitude et tout notre respect Madame Deborah Voigt.
Michel Olivié, mars 2016