 A l’occasion de la sortie chez Warner Classics d’un coffret des enregistrements faits par Wilhelm Furtwängler, Christian Merlin publie dans le Figaro de ce 30 septembre brossant un rapide portrait de ce grand chef.
A l’occasion de la sortie chez Warner Classics d’un coffret des enregistrements faits par Wilhelm Furtwängler, Christian Merlin publie dans le Figaro de ce 30 septembre brossant un rapide portrait de ce grand chef.

Wilhelm Furtwängler dirigeant l’Orchestre philharmonique de Berlin, au Titania-Palast, à Berlin-Steglitz vers 1950. akg-images
Un coffret de 55 CD dédié à l’un des plus importants chefs d’orchestre de l’histoire du classique permet de comprendre qu’il était autant un créateur qu’un interprète.
Le coffret de 55 CD que Warner Classics consacre à l’art du chef Wilhelm Furtwängler (1886-1954) est un événement capital. Furtwängler incarna la quintessence du chef d’orchestre visionnaire, et la fascination qu’il exerce est à la mesure de la détestation dont il peut être l’objet: on est pour ou contre, jamais au milieu. Après des débuts pour le moins laborieux, ce fils d’un archéologue découvreur du site d’Égine, en Grèce, devient en 1922 la personnalité musicale la plus influente de l’aire germanophone, en succédant à Arthur Nikisch, son modèle, dans ses fonctions de directeur musical du Philharmonique de Berlin et du Gewandhaus de Leipzig. Incarnant la rivalité entre Berlin et Vienne, il ajoute en 1927 la direction des concerts du Philharmonique de Vienne, mais refusera la direction de l’Opéra de Vienne, incompatible avec ses obligations berlinoises: blessure pour les Viennois avec lesquels il gardera cependant un lien ininterrompu.
Cet idéaliste du XIXe siècle se trompe sur l’avenir de Hitler, déclarant six mois avant son accession au pouvoir: «Jamais ce camelot à la parole chuintante ne jouera un rôle quelconque dans la politique allemande.» Admiré du Führer, il est resté en Allemagne pendant le nazisme. On sait que, au début, il fit son possible pour éviter les lois antisémites au Philharmonique de Berlin et joua les musiques interdites. Goebbels se méfiait de lui, Himmler le mit sous surveillance, Goering propulsa le jeune Karajan pour le concurrencer. Mais son attitude resta ambivalente, et lors de la procédure de dénazification, le général McClure (incarné par Claude Brasseur dans la pièce où Michel Bouquet était Furtwängler) lui reprocha d’avoir donné une «aura de respectabilité au régime».
À l’écrivain Thomas Mann, exilé aux États-Unis, qui se demande comment Furtwängler peut diriger Fidelio dans l’Allemagne de Himmler sans avoir envie de se prendre la tête entre les mains, il réplique: «Thomas Mann croit-il vraiment que dans l’Allemagne de Himmler on ne devait pas jouer Beethoven? Ne peut-il réaliser que les gens n’ont jamais eu autant besoin d’entendre Beethoven et son message de liberté et d’amour humain?» Le drame, c’est qu’ils ont raison tous les deux. En enregistrant avec lui en 1947, Yehudi Menuhin le blanchit avec beaucoup de noblesse.
Son approche de la musique était liée à une vision philosophique de l’art. La musique relevait pour lui d’une expérience vécue, irrationnelle. Il considérait l’œuvre comme un organisme vivant doté de sa croissance et de ses transformations, semblable à la métamorphose des plantes. D’où sa conception souple du tempo, jamais métronomique, tout en transitions. C’est pourquoi on l’a toujours opposé à l’autre pôle que représentait Arturo Toscanini, avec sa recherche de clarté, d’exactitude, de symétrie.
Érudition captivante
On l’accusa d’imprécision, ironisant sur sa gestuelle floue, mais entendre un orchestre qui attaque ensemble ne l’intéressait pas. En réécoutant ces interprétations, on a plus d’une fois l’impression que, lorsque l’orchestre démarre, le son avait déjà commencé. Ses interprétations se développent sur de grandes arches, plus importantes que la précision du détail. On en a conclu qu’il était hostile au disque, à cause de son découpage en séquences. Cette intégrale permet de se rendre compte qu’il n’en est rien, et qu’il s’est laissé très tôt convaincre de l’importance de ce nouveau moyen de communication: ses premiers enregistrements datent de 1926.
Le coffret réunit la totalité des enregistrements commerciaux de Furtwängler. Ceux réalisés en studio, mais aussi quelques live expressément destinés au disque, comme la célébrissime Neuvième de Beethoven à Bayreuth en 1951, mais aussi de captivants extraits wagnériens de 1937 à Londres, avec une distribution vertigineuse. La plupart sont du catalogue EMI (His Master’s Voice fut son plus fidèle éditeur), mais on trouve aussi les enregistrements pour DG et Decca. Le travail éditorial de Christophe Hénault est exemplaire de rigueur: chaque fois que c’était possible, les matrices originales ont été retrouvées, les prises additionnelles ajoutées, et la restitution sonore est un modèle du genre. Le texte de présentation de Stéphane Topakian remet en perspective l’histoire de Furtwängler au disque avec l’érudition la plus captivante.
Les orchestres sont principalement les Philharmoniques de Vienne (58 enregistrements) et Berlin (43). Les compositeurs les plus présents sur les 55 CD sont Wagner (24 œuvres), Beethoven (22) et Brahms (10), avec d’intéressants pas de côté vers Tchaïkovski ou des pièces de genre. La logique éditoriale laisse de côté la discographie live, véritable forêt vierge. On n’y trouvera donc pas la Première de Brahms à Radio Hambourg, ni les concerts et opéras de Salzbourg. Pas même une symphonie de Bruckner complète, puisqu’il n’a pas enregistré en studio ce compositeur cher à son cœur. Quant aux incroyables bandes radiophoniques de la guerre, plus survoltées que les disques plus tardifs, le label du Philharmonique de Berlin les a réunies en 2019 en un coffret de 22 CD. Ce que nous offre Warner aujourd’hui, c’est de disposer dans toute sa vérité du legs officiel d’un chef créateur autant qu’interprète, pour qui la musique avait partie liée avec la transcendance.
POUR RAPPEL, voici le lien avec l’article de Michel Olivié paru dans la revue 2017 de notre cercle, à propos de ce grand chef d’orchestre



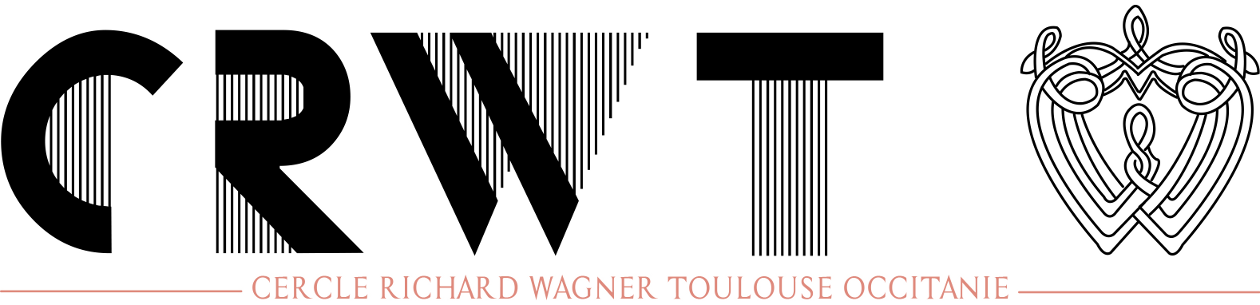
 A l’occasion de la sortie chez Warner Classics d’un coffret des enregistrements faits par Wilhelm Furtwängler, Christian Merlin publie dans le Figaro de ce 30 septembre brossant un rapide portrait de ce grand chef.
A l’occasion de la sortie chez Warner Classics d’un coffret des enregistrements faits par Wilhelm Furtwängler, Christian Merlin publie dans le Figaro de ce 30 septembre brossant un rapide portrait de ce grand chef.
