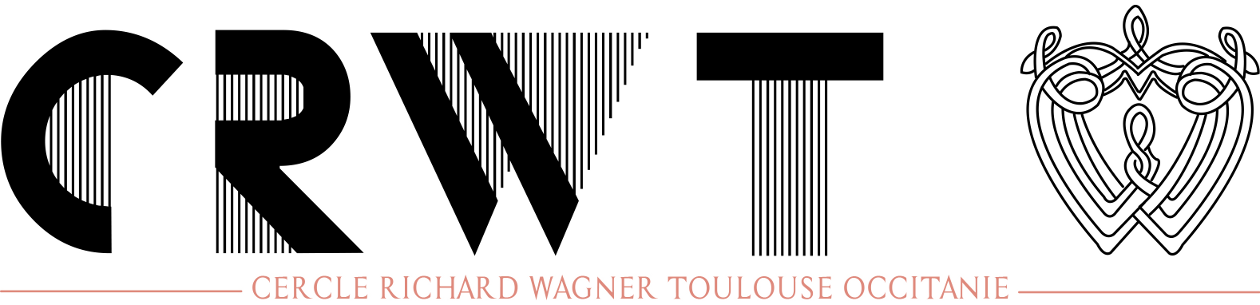Madame Louise Meyerson Vetta-Karst était une personne très jolie à la constitution osseuse délicate, aux grands yeux bleus verts, aux lourds cheveux auburn rassemblés au somment de la tête, à la peau de crème pure, aux noirs sourcils en points d’exclamation. Elle avait un caractère particulièrement dominateur. Par-dessus tout elle aimait chanter et tout de suite après, elle aimait entendre chanter Helen Traubel.  Lulu, comme ses amis l’appelaient, avait été très proche, dans ses jeunes années, de Chouteau, un chasseur de fourrures et un des premiers pionniers du poste de commerce de Saint Louis, Missouri. Très jeune aussi elle avait voyagé en Europe et vécu là-bas pour un temps. Puis elle revint et se maria avec le consul de France de Saint Louis. Six ou sept années plus tard elle divorça, revint en France et entra à la Sorbonne pour étudier la musique durant dix-sept ans. Elle avait tout appris dans ce domaine. Et elle était absolument déterminée à transmettre tout son savoir aux générations futures. Helen Traubel fut l’élue choisie pour recevoir cet héritage.
Lulu, comme ses amis l’appelaient, avait été très proche, dans ses jeunes années, de Chouteau, un chasseur de fourrures et un des premiers pionniers du poste de commerce de Saint Louis, Missouri. Très jeune aussi elle avait voyagé en Europe et vécu là-bas pour un temps. Puis elle revint et se maria avec le consul de France de Saint Louis. Six ou sept années plus tard elle divorça, revint en France et entra à la Sorbonne pour étudier la musique durant dix-sept ans. Elle avait tout appris dans ce domaine. Et elle était absolument déterminée à transmettre tout son savoir aux générations futures. Helen Traubel fut l’élue choisie pour recevoir cet héritage.
Quand Helen Traubel, encore une petite fille de douze ans, annonça à ses parents, dans la maison familiale de Saint Louis, qu’elle voulait devenir une vraie chanteuse, et combien peu lui importait de travailler de toutes ses forces pour y parvenir, sa mère posa une seule condition : que Louise Meyerson Vetta-Karst soit son professeur.
Helen chantait à cette période dans le chœur catholique romain de Saint Louis. Elle avait quelques amis d’origine italienne impressionnés par sa voix, qui la pressaient de prendre des leçons de chant. Elle refusait toujours se souvenant de la condition posée par sa mère. ‘’Au moins, lui dirent-ils, pourquoi ne vas-tu pas voir quelqu’un qui pourra réellement te dire quel trésor tu as dans ta gorge ?’’ Elle finit par céder, et alla voir un fameux professeur de musique hautement respecté dans la société cultivée de Saint Louis. Il passait cinq ou six mois par an en Europe et était critique musical au Saint Louis Times. Helen était impressionnée par sa réputation, mais déterminée à lui montrer ce qu’elle savait faire. Son accompagnatrice était l’organiste de l’église, dont le nom était Ave Maria (elle venait d’une famille vraiment catholique.) Ave Maria commença à jouer nerveusement, le professeur en profitait pour ouvrir son courrier, ‘’Quelles mauvaises manières’’ pensa Helen. L’air qu’elle avait choisi débutait par une très haute note soutenue. Aussitôt que la note frappa son tympan, l’homme sursauta comme s’il avait reçu un coup de couteau. Il ne la laissa pas terminer. Il cria : ‘’Mon Dieu, quel est ton nom? ‘’ Helen le lui dit et ajouta qu’elle avait presque treize ans. Il hocha la tête. ‘’Je sais que je ne me trompe pas, mais c’est quelque chose d’important dont il faut être sûr.’’
Il la traîna hors du studio et frappa à une autre porte. Il entra et Helen entendit un bruit de conversation. Il ressortit échevelé et soufflant et la conduisit à l’intérieur. Une femme d’une réelle beauté, une cigarette à la bouche, de la cendre tombée sur le devant de sa robe, d’ une soixantaine d’années, la regardait intensément. ‘’Chante’’ lui dit-elle de sa voix grave. Elle reprit l’air qu’elle avait déjà chanté au professeur de piano. L’auditrice parut peu impressionnée. Elle se leva et la regarda attentivement. ‘’Quel est ton nom ? quel âge as-tu ? où vis-tu ? puis elle se tut. Finalement : ‘’Je veux t’enseigner ma fille’’ – je suis désolée, dit Helen avec fermeté, ma mère ne veut pas que je prenne des leçons de qui que ce soit à l’exception d’une femme qu’elle connait depuis l’enfance, je suis vraiment désolée. La femme tira fortement sur sa cigarette : ‘’Ca n’a pas de sens, quel est le nom de ta mère?’’ – Madame Traubel La femme secoua la tête avec impatience : ‘’Quel est le nom de ce merveilleux professeur auquel elle veut t’envoyer ?’’ – Une femme qui s’appelle Lulu Meyerson. Un changement intervint sur le visage de la femme. Les lignes dures se transformèrent. ‘’Dis-moi petite, quel est le nom de jeune fille de ta mère ?’’ – Clara Stuhr dit-elle — ‘’le numéro, petite.’’ Helen le lui donna. Elle le composa et attendit : ‘’Clara, C’est Lulu, Lulu Meyerson ‘’. A partir de ce moment-là, elle fut comme une seconde mère pour Helen. Durant dix-huit ans elle ne chanta nulle part dans le monde à moins que Lulu ne le lui permette. Elle ne lui prit jamais un centime. Le prix des leçons était habituellement de trois dollars de l’heure, au bout de deux mois, Helen lui apporta un chèque de trente–six dollars que lui avait donné sa mère. Lulu refusa et Helen rapporta le chèque à sa mère. Aussitôt elle devint furieuse et se rua sur le téléphone pour protester. Helen se souvint d’entendre encore la voix tranchante de Lulu, comme si elle voulait qu’Helen entendit aussi : ‘’Clara, je veux contrôler Helen. Je veux avoir prise sur elle. Si elle sent qu’elle est mon obligée, j’aurais encore plus de prise sur elle. Comme tu le sais, elle est parfois entêtée et n’en fait qu’à sa tête. Il y aura beaucoup à faire avant qu’elle chante, je veux dire qu’elle chante selon la route que je veux pour elle.’’
Et en effet Helen Traubel, dans bien des occasions cruciales de sa carrière, n’hésita pas à rejeter les offres flatteuses que l’on pouvait lui faire. Jamais elle ne se sentait prête pour le répertoire qu’on lui demandait, pas plus qu’elle ne voulait recevoir de leçons de chants venant des professeurs les plus réputés sur New York. C’était l’effet de l’exigence de l’apprentissage auquel Louise Meyerson la soumettait à proportion des progrès de ses qualités vocales. Et elle conduisait la carrière d’Helen Traubel d’une main de fer : ’’Tu n’es jamais contente de ce que je fais’’ lui disait-elle ‘’le jour où je le serai tu ne me verras plus’’ lui répondait l’autre. Helen n’avait alors pas d’autre solution que de lui rétorquer ‘’Tu ne me verras jamais pleurer’’. Les artistes acceptant de faire preuve de tant d’humilité sont rares. Cela suppose une grande abnégation, un souci d’être au service de l’art auquel on se consacre bien peu répandu. Et là se trouve la grandeur d’Helen Traubel.
En 1926, soit à peu près dix ans après sa rencontre avec Louise Meyerson, Rudolf Ganzes le chef de l’orchestre de Saint Louis la présenta à une femme professeur de chant mondialement appréciée. Après qu’elle l’eut entendue dans l’air de Louise, qu’elle fut impressionnée et qu’elle lui proposa de la prendre comme élève, elle s’entendit demander de la part d’Helen quelle était sa théorie, comment elle allait lui enseigner ce qu’elle voulait lui apprendre. Helen n’avait pas besoin de quelqu’un qui lui montrerait comment produire une tonalité, cela elle le tenait déjà de Lulu. Ce qu’elle voulait c’est qu’on lui enseigna comment aborder un air, produire ce qu’une audience attendait. Elle lui demanda ce qu’elle voulait d’elle en pratique. Pincée, l’autre lui répondit qu’elle pouvait l’amener en France, qu’elle conduisait une école de chant tous les ans à Fontainebleau, dix ou douze élèves payaient quatre mille dollars pour leur stage, mais que pour elle, elle le ferait pour rien, qu’elle paierait toutes les dépenses et en ferait son élève. Helen fut très touchée, mais osa lui demander de lui donner le nom d’un artiste qui aurait suivi son enseignement et qui aurait du succès. Interloquée son interlocutrice lui désigna quand même un nom, mais il se trouva qu’Helen le tenait pour un amateur. Elles se séparèrent sur un au revoir murmuré.
Ses débuts new yorkais, vers le milieu des années vingt, conjuguaient son souci de progresser dans la maîtrise de sa voix — chaque étape réalisée la rapprochant et l’éloignant à la fois de ce qu’elle voulait atteindre — et les sollicitations des agents musicaux qui l’entendaient au gré des concerts auxquels elle participait ici ou là. Véritablement, elle ferraillait avec eux. Tout d’abord avec Arthur Judson, un agent musical très prisé pour ses succès dans la scène artistique. Il lui proposa une série de concerts en Europe : sous la direction d’un grand chef, lui dit-il mystérieusement. Elle refusa. ‘’ Pourquoi ?’’ ‘’Je ne suis pas prête’’, dit-elle automatiquement – ‘’ Et quand serez-vous prête ?’’ ‘’ Je ne sais pas, je sais seulement que je ne suis pas prête maintenant’’ — ‘’Pourquoi ?’’ ‘’ Je ne suis pas satisfaite de mon son et de ma façon de conduire les airs’’ – ‘’Qu’avez-vous en tête?’’ ‘’ Rien, excepté d’étudier.’’ Mais sa curiosité était éveillée, et elle accepta les dix mille dollars qu’il lui offrait contre quatre mois de concerts partagés avec d’autres d’artistes. Ce fut pour elle aussi le moyen de progresser dans l’art de la scène.
Vint le tour de Walter Damrosch, quatre ans plus tard, à Saint Louis — puisqu’Helen Traubel ne pouvait se décider à s’éloigner pour de bon de sa ville natale — qui dirigeait l’orchestre du Metropolitan, le Philharmonic de New York, et était compositeur. Il l’engagea à la suite d’une répétition durant laquelle il fut subjugué, et lui proposa un concert sur place incluant l’aria de Tannhäuser et le Liebestod. Il était indigné : comment pouvait-elle se cacher dans ce trou perdu ! elle devait venir à New York ! Elle le remercia, mais refusa. ‘’ Pourquoi ?’’ ‘’ Je ne suis pas prête’’ – ‘’ J’ai dirigé Johanna Gadski, une des plus grandes chanteuses entre les années 1895 et 1917, j’ai cherché, durant ces dernières années, à trouver une autre voix et quand je la trouve, elle me dit qu’elle n’est pas prête!’’ Helen s’excusa, lui dit que ce qu’elle ressentait profondément était qu’elle devait continuer à progresser. En désespoir de cause il lui proposa d’introduire un rôle féminin dans l’opéra qu’il venait de composer The man without a country. Helen accepta, et cela se fit plus tard.
Mais celui qui eut le plus dur combat à mener avec Helen Traubel fut Edward Jonhson le directeur du Metropolitan de New York. Auparavant, elle avait pris l’initiative de préparer un concert au Town Hall de New York pour le 8 octobre 1939, accompagnée par Coenraad Bos au piano. La presse loua unanimement sa prestation. A l’issu de ce concert, le lendemain matin, elle reçut un coup de téléphone du secrétariat du Metropolitan lui disant que le directeur voulait la voir au plus tôt. Il la reçut en effet dans son bureau et lui annonça qu’ils seraient très heureux de l’engager dans le rôle de Vénus dans Tannhäuser. Elle lui dit non. Il tenta de la convaincre. Non merci, dit-elle en s’en alla.
Le 22 octobre, elle donna un concert au Carnegie Hall accompagnée par le New York Philharmonic sous la direction de John Barbirolli. Son interprétation de l’immolation de Brünnhilde enthousiasma la presse. Le téléphone sonna à nouveau le lendemain matin du concert. Avec enthousiasme Johnson lui proposa à nouveau le rôle de Vénus. Elle lui redit non. ‘’Vous ne pouvez pas refuser!’’ lui dit-il. Il pressa un bouton placé sur son bureau et ce fut Edward Ziegler, le bras droit de Johnson qui entra : ‘’Hello, comment allez-vous Helen, je suis si heureux de vous voir’’, et il repartit. Elle fut décontenancée, ‘’ Que voulez-vous chanter pour nous?’’ ‘’Je voudrais chanter le rôle de Sieglinde dans la Walkyrie’’. Johnson semblait très détendue ‘’Il me suffit d’appuyer sur cette sonnette et j’aurais six Sieglinde à l’instant.’’ ‘’ Bon, je voudrais assister à des répétitions et voir si je peux tenir le rôle ou non.’’ ‘’ Non, non, non, nous ne pouvons permettre à personne en dehors des membres de la compagnie du Metropolitan d’assister aux répétitions. Maintenant pour ce qui concerne Vénus…’’ ‘’C’est impossible, totalement impossible’’ dit-elle. Il bondit de sa chaise, martela la table : ’’ je vais me mettre en rogne ! J’ai du sang irlandais dans les veines!’’ ‘’ Eh bien moi j’ai du sang allemand’’, elle se mit à rire.’’ Vous n’allez pas me dire comment diriger l’Opéra!’’ ‘’ Et vous me dire comment je dois conduire ma carrière, ni vous, ni Ziegler ou qui que ce soit. Monsieur Edward Johnson, dit-elle en montant le ton, vous pouvez vous mettre le Metropolitan Opéra où je pense’’. Elle partit.
Elle reçut de nombreux autres appels du Metropolitan disant que Johnson voulait qu’elle revienne le voir. Elle refusait toujours elle reçut un télégramme et fit la même réponse : non. Elle continua à donner des récitals de mieux en mieux accueillis. A la mi-décembre 1940 Le Metropolitan appela, elle raccrocha. La situation nécessitait un médiateur. Ce fut un homme de loi de réputation internationale, William Matheus Sullivan qui se proposa. Sur ses indications Helen écrivit une lettre dans laquelle elle disait qu’elle serait maintenant et toujours, heureuse de chanter au Metropolitan Opéra. Elle spécifiait qu’elle tenait un contrat tout près et ajoutait qu’elle voudrait débuter dans le rôle de Sieglinde de Wagner. Il y eut une réponse immédiate, cette fois de Ziegler. Il agréait à tous les termes de la lettre. Il appellerait pour une répétition spéciale il fallait qu’elle se tienne prête. Sullivan lui fit des dernières recommandations : ‘’ Souvenez–vous, ne chantez aucune note tant que vous n’aurez pas signé le contrat.’’ Elle se rendit au Metropolitan.’’ Vous êtes en avance’’ lui dit Johnson. –‘’ En effet dit-elle, je suis venue pour le contrat et le rôle de Sieglinde’’ — ‘’Vous voulez que le contrat contienne la promesse que vous chanterez Sieglinde ?’’ –Oui –‘’ Mais c’est impossible, on ne mettra jamais ça dans le contrat, ça ne s’est jamais fait.’’ Ziegler intervint : ‘’Nous le ferons cette fois-ci. S’il vous plaît Monsieur Johnson prenez le contrat et signez –le.’’ Ce fut fait. Au bras de Ziegler elle prit l’ascenseur qui conduisait à la salle de répétition sous les toits du Metropolitan. Quand elle entra, les musiciens, plus de cent, avec lesquels, pour certains, elle avait chanté, se levèrent et l’applaudirent. Elle avait gagné la bataille. Elle pouvait débuter au Metropolitan dans le rôle de Sieglinde. Durant de longues années les relations avec Edward Johnson furent très fructueuses et très chaleureuses.
Ce ne fut qu’à son entrée au Metropolitan qu’Helen Traubel prit conscience de l’importance de l’enseignement de Louise Meyerson. A la solidité de cet apprentissage s’ajoutait une constitution physique exceptionnelle héritée de sa mère. Ses épaules athlétiquement musclées étaient soutenues par une cage thoracique hors du commun. Elle apprit à chanter comme Lulu le lui avait enseigné : se déplacer dans la pièce en agitant les bras, en tenant toujours le diaphragme stable. Elle apprit à chanter à genoux, allongée sur le sol, appuyée sue les coudes, avec toujours la constante admonestation de Lulu ‘’Tiens ton souffle dans un étau !’’ Lorsqu’elle prenait un souffle profond et le déployait, l’effet produit était celui d’une immense explosion. Ces dispositions lui permirent de tenir tête à celui qui fut son partenaire de scène durant de nombreuses années : Lauritz Melchior. Tous les deux entraient en compétition pour la plus longue note tenue. Il la battait souvent parce qu’il n’hésitait pas à devenir cramoisi. L’habituelle plaisanterie d’Helen à l’adresse de Lauritz Melchior, les soirs d’opéra, consistait à lui dire : ‘’How long tonight, Lauritz?’’
L’apprentissage auquel Louise Meyerson soumit Helen Traubel fut des plus sévères, et sans qu’Helen le vive autrement que comme une grande satisfaction et un grand contentement. Elle lui faisait faire des gammes pendant un mois puis lui permettait d’apprendre un air. A nouveaux six semaines de gammes et un nouvel air. Louise Meyerson lui permit d’ajouter trois notes au-dessus et quatre notes en dessous de ce qui lui était naturel. Cela lui permit d’accéder à des lignes pures et de maintenir les notes en suspens. Travailler la voix et réserver le chant comme aboutissement de cette voix comme instrument étaient le credo de Louise Meyerson. « Ta voix est un instrument et seulement un instrument. Quiconque penserait autrement ne serait pas un chanteur mais en exhibitionniste.» lui disait-elle. Du début jusqu’à la fin de son apprentissage, durant dix-sept ans Helen Traubel n’eut jamais le sentiment de perdre une seule minute.
La complicité que le progrès de la voix impliquait entre elles pouvait se mesurer aux insultes qu’elles échangeaient dans l’ardeur de l’apprentissage : « Tu es une feignasse stupide et idiote ! Tu ne peux rien apprendre tu ne seras jamais importante! » — Et toi tu es une grosse vache, tu ne peux pas faire mieux que ce que je fais! » Il y a des insultes, disait Helen Traubel, pour lesquelles elle aurait aimé la récompenser. Elle y parvint en partie et Lulu en convint, en devenant la chanteuse qu’elle était devenue. Grâce à ces années elle n’a jamais pensé le chant en termes de facile ou difficile. Simplement elle aimait faire usage de sa voix en longues phrases expansives que lui permettait son exceptionnelle constitution physique. Si elle devint une soprano quasi exclusivement wagnérienne, c’est parce qu’il n’y avait pas grand monde ayant une telle structure pour tenir ces rôles.
Qu’elle tienne à mettre en avant tout d’abord cette explication atteste de son appartenance revendiquée au monde américain. Les bienfaits de la philosophie pragmatique d’un William James épargnent bien des fautes d’orgueil ou des justifications d’une métaphysique aléatoire qui embarrassent bien des approches de l’art wagnérien. L’insistance sur un considérable travail journalier durant de très longues années est une seconde revendication tenant à l’écart toute vocation qui s’en conterait. L’économie dans l’approche atteignit son sommet, sans doute, quand elle ramena le 1er acte de la Walkyrie à ce résumé : « L’intrigue est la suivante, Sieglinde est mariée à un vieil homme et est amoureuse d’un plus jeune. » La philosophie américaine est une lointaine héritière du rasoir d’Occam… Elle assumait pleinement de n’avoir interprété que neuf rôles dans sa carrière, et essentiellement des rôles wagnériens. Elle n’a jamais voulu plus, uniquement soucieuse de les chanter à la perfection.
Elle interpréta sa première Sieglinde au Metropolitan le 28 décembre 1939. Elle apprit les deux Brünnhilde, celle de La Walkyrie et celle du Crépuscule pour la saison 1940-41. Ce fut ensuite les rôles d’Isolde et de la Brünnhilde du Siegfried pour la saison 1942-43. Elsa vint en 1944-45 (Lulu lui avait interdit de l’aborder jusqu’alors) et enfin Kundry en 1946-47. Durant ces années le Metropolitan accueillait les noms les plus prestigieux de la scène wagnérienne. Helen Traubel avait pour partenaires Kirsten Flagstad, Marjorie Lawrence, Lotte Lehmann, Astrid Varnay, Kerstin Thorborg, Lauritz Melchior, Friedrich Schorr.
Melchior fut son partenaire habituel durant ces années. Ils furent de grands amis. A l’occasion d’un safari qu’il fit en Afrique, il fit expédier à Helen deux lionceaux, dont elle fit don au zoo de Saint Louis, et le directeur les baptisa Helen et Lauritz.
Flagstad était au sommet de son art à cette époque-là, mais lassée de chanter et soucieuse de regagner la Suède dans ces débuts d’années de guerre, elle lui disait : «Traubel, je suis si fatiguée! J’ai tellement chanté. Nous pourrions échanger nos rôles de temps à autre, Traubel. Je chanterais Sieglinde et toi Brünnhilde, eh? » Ou bien : « Traubel, je veux arrêter cette folie de chant et rentrer chez moi ! « C’était pathétique pour moi et tragique pour elle. » commentait Helen Traubel.
Kirsten Flagstad rejoignit en effet son pays, et Marjorie Lawrence dut quitter tragiquement la scène, atteinte de poliomyélite. Helen Traubel se retrouvait seule sans véritable rivale pour les cinq années à venir.
Le chef attitré du Metropolitan de ces années–là était Erich Leindorff duquel Helen Traubel souligne la solidité du travail plus que le souci du panache. La majeure partie des enregistrements du Ring du Metropolitan des années 40 sont sous sa direction.
C’est en Toscanini qu’elle trouva le chef qui lui permit d’exprimer au mieux sa recherche de la perfection du chant wagnérien. Mais cette rencontre est révélatrice de l’approche singulière qu’Helen Traubel réserva à la musique de Wagner. Les raisons pour lesquelles elle préférait l’interpréter sous la forme de pièces de concert plus que dans l’intégralité de l’œuvre tiennent à la fois de son appréciation du livret (elle trouvait dans le texte des livrets quelque chose relevant de la posture et bien trop déclamatoire, elle remarquait la manie de Wagner d’écrire une phrase et de répéter la même chose un peu plus bas. Elle trouvait qu’il abusait des allitérations. Elle donna un avis définitif bien que contestable : ‘’S’il ne pouvait pas écrire les mots, au moins il pouvait écrire la musique.’’ L’allemand était sa langue natale et c’était en allemand que la famille Traubel conversait.) et à ce qu’elle voulait obtenir de son chant. Et son but fut atteint au Carnegie Hall, en 1941 où elle chanta la scène finale du Götterdämmerung sous la direction de Toscanini. Elle atteignit le même but avec la mort d’Isolde, non lors sa première de Tristan et Isolde, le 4 décembre 1942, au Metropolitan, toujours avec Melchior, mais ultérieurement en concert, en ne chantant que le Liebestod. Car elle-même estimait n’avoir chanté Isolde correctement qu’après trente-cinq représentations. Ce n’est qu’en 1946 qu’elle put dire qu’elle pouvait rendre toutes les nuances du rôle.
Sa conviction profonde était que les opéras de Wagner échappaient à un large public, mais que sa musique—détachée de toute sa théâtralité—retrouvait toute sa dimension sublime. La réalité était qu’elle ne vouait pas à l’opéra en général et au Metropolitan en particulier un amour immodéré. Elle-même se vivait comme une iconoclaste, au Metropolitan elle était comme un taureau dans un magasin de porcelaines chinoises, selon son expression. Dans son esprit la musique populaire américaine avait autant de valeur que l’opéra et avait le mérite de faire accéder plus de monde à la musique. Saint Louis Blues ne déméritait en rien face à quelques airs d’opéra.
Durant la deuxième guerre mondiale et la guerre de Corée elle donna de très nombreux concerts auprès des troupes engagées. Si elle n’avait chanté que des airs d’opéra son intention initiale, procurer du plaisir et du divertissement aux combattants aurait manqué son but. Mais elle reçut des accueils enthousiastes en chantant ‘’Deep River’’, ‘’Swing Low, Sweet Chariot’’, ‘’Rainy night in Soho’’ à côté du répertoire d’opéra. La troupe lui signifia de la façon la plus bruyantes à quel point elle était sensible à sa présence. Cela la libéra du sentiment d’isolement vis-à-vis du grand public qu’elle éprouvait en chantant exclusivement les œuvres de Wagner. Sa nature profondément ancrée dans la vie démocratique américaine fut pleinement contentée dans cet engagement guerrier. Elle prouva cet ancrage en en remontrant à un soldat qui manifestait sa joie en sifflant entre ses dents : « J’ai un petit frère qui sait siffler aussi bien que toi, et il m’a appris à moi aussi.» et c’est ce qu’elle fit. Une drôle de coïncidence voulut que le 6 décembre 1941 elle chanta pour la première fois le rôle de Brünnhilde de la Walkyrie au Metropolitan. Après la représentation elle regagna l’Hôtel Plaza avec Bill son mari. Ce fut leur ami juriste William Sullivan qui leur apprit la terrible nouvelle de l’attaque de Pearl Harbor. Combien de militaires ont-ils été surpris, durant la retransmission de l’opéra à la radio, par l’explosion des bombes japonaises et combien seraient morts en entendant en leur dernier instant le ‘Ho-yo-to-ho’ d’Helen Traubel ou cela aurait-il été l’annonce de la mort de la Walkyrie à Siegmund ?
En étant acclamée comme une soprano wagnérienne de premier plan, une décade après ses débuts au Metropolitan, elle eut tout à coup le sentiment qu’elle était passée à côté du cœur de la musique. Elle se rappela les chansons de fête informelles de son enfance à Sant Louis, les succès de ses concerts remportés dernièrement durant son tour du monde, à Tokyo, en Inde, en Amérique du sud où là aussi elle mêlait chansons populaires et airs d’opéra. Ce fut pour elle une évidence : il y avait un immense auditoire qui attendait sa voix avec impatience pour une musique d’une autre sorte que celle du cercle spécialisé des amateurs d’opéra.
Elle décida d’accepter de chanter Chez Paree un très célèbre night-club de Chicago en septembre 1953. Edward Johnson avait quitté la direction du Metropolitan et avait été remplacé par Rudolph Bing. Dès qu’il apprit qu’Helen Traubel acceptait de chanter dans un night-club il lui fit savoir par lettre que sa double activité de chanteuse d’opéra et de chanteuse de music-hall ne s’accordaient en aucune façon. Peut être préférerait-elle faire une pause avec le Metropolitan pour une année ou plus, jusqu’à ce qu’elle éprouve le besoin de revenir à une forme plus sérieuse de son art. Il ajoutait en fin de lettre : Qu’«il considérait comme hautement indésirable que la publicité pour quelque night-club que ce soit apparaisse avant, pendant ou après, à côté de sa présence au Metropolitan. Pouvait-il avoir son assurance sur ce point ? » Elle lui répondit : « Affirmer que l’art peut se trouver au Metropolitan Opera House et non dans un night-club sentait le snobisme et sous estimait le goût du public américain et le talent de ses compositeurs.» Bing en prit acte et refusa de lui faire signer une nouvelle saison tant qu’elle resterait sur des positions de si mauvais goût. Le 11 mars 1953 vit sa dernière apparition au Metropolitan dans le rôle d’Isolde.
Elle commença alors une riche carrière, non seulement en chantant dans des night-clubs (et la réflexion que lui fit un jour un des quatre associés du Chez Paree, nous projette soudain dans un épisode de Soprano. il lui dit « A n’importe quel moment, et qui que ce soit, vous crée des ennuis où que ce soit aux Etats-Unis, dites-le moi. ») mais aussi en faisant de multiples apparitions dans des émissions de télévision populaires. Elle fut la partenaire de Jerry Lewis au cinéma, celle de Groucho Marx dans l’opérette de Gilbert et Sullivan the Mikado or the Town of Titipu, elle y tenait le rôle de Katisha. Elle tourna également des films. Helen Traubel pouvait enfin donner libre cours à son immense éclat de rire qui était un trait essentiel de son caractère, depuis son enfance. Mais le meilleur était à venir : elle écrivit des romans policiers.
Ne pouvant le trouver en vente je suis actuellement en relation avec des bibliothèques américaines afin de pouvoir me procurer son premier roman The Ptomaine Canary, dont l’héroïne est une Brünnhilde Wagner qui seconde le héros policier Sam Quentin. Nous retrouvons ce dernier dans son second roman, que j’ai lu cette fois : The Metropolitan Opera Murders, on devine que l’héroïne, Elsa Vaughn n’est autre qu’Helen Traubel. Un extrait (cela se passe lors d’une représentation de Tristan und Isolde au moment de l’entracte à la fin du deuxième acte) : « elle ouvrit la porte de sa loge. L’élan la porta à l’intérieur et le choc l’arrêta court. Quelqu’un avait usurpé ses quartiers. Quelqu’un était sur sa chaise – Hilda Semper pour être exact. Elle était assise sa tête blonde affaissée en avant sur la coiffeuse, une ligne hésitante de scintillement cramoisi s’échappant de l’orifice fait par la balle.
La vision paralysa tous les muscles d’Elsa excepté ceux qui contrôlent l’émission de la voix. Combien de décibels produisit son cri, pendant que le pivot de sa mâchoire demeurait ouvert, personne ne le saura. Les instruments mécaniques qui mesurent le son n’étaient pas en service à ce moment-là. Alimenté par vingt ans dépensés à développer ses poumons, son larynx et son diaphragme, fortifié par un cri de guerre de la Walkyrie sans nombre, c’était un son impressionnant qui aurait pu agiter les sismographes de la moitié du continent. Pour la première fois dans l’histoire de l’opéra un soprano dramatique atteignit le fa au-dessus du do majeur… »
Mais il ne faut pas se laisser abuser, pour Helen Traubel le chant lyrique fut l’axe de sa vie. Sa réflexion au terme de sa carrière précise qu’au-delà des plaisirs sensoriels –aimer les bonnes choses, avoir de longues conversations avec ses amis autour d’une table, la délicieuse sensation procurée par la natation – elle ne peut pas se rappeler quand elle a commencé à chérir et entraîner sa voix, quand elle n’a pas passé une heure de la journée à la travailler. Même en dormant, elle pense qu’elle est encore en train de faire des gammes avec Lulu. La vie a été travail pour elle, et elle espère qu’il en sera de même au ciel.
Malgré les réserves qu’elle a pu faire sur les opéras wagnériens et surtout sur le milieu wagnérien, elle reconnaissait qu’elle se définissait elle-même comme un soprano wagnérien. La musique l’a choisie, ce n’est pas elle qui a choisi. Chaque composition de Wagner est à la fois un ruisseau et une rivière. L’un grandit dans l’autre et déverse son trop-plein dans l’oreille. L’expérience la plus puissante de toute sa vie fut de se trouver seule entourée de cent instrumentistes déployant la musique de Wagner comme à l’infini. Elle, au centre de cela, enveloppée encore, encore et encore, lovée dans d’énormes couvertures de sons délicieux. Elle n’avait pas à se battre beaucoup contre le sentiment de ne plus être un être humain, mais une pièce de bois ou de métal, un instrument contribuant au son. Elle acquit la réputation d’être la chanteuse des musiciens, et elle fut touchée jusqu’ au fond de l’âme lorsqu’un des musiciens du Metropolitan lui dit un jour : « Il n’y a personne qui puisse apprécier les qualités que vous apportez à l’opéra, Miss Traubel, mieux que nous. Nous avons passé notre vie à produire votre genre de son. »
Le commentaire qu’Helen Traubel faisait de la didascalie de la fin du Götterdämmerung résumait à la fois sa moquerie et son respect pour la musique de Wagner. ‘’Le premier metteur en scène venu vous dira, que le seul endroit qui pourrait littéralement abriter une telle scène, serait un asile de fous placé dans le Colisée de Rome. Ce que Wagner décrit est véritablement la fin du monde, ce qui pour lui était la chose la plus naturelle qui soit. Aussi absurde que soit cette conception, une musique de la fin du monde correspond bien à l’essor de sa pensée.’’ Mais elle ajoutait qu’elle avait toujours imaginé que si un jour le monde arrivait à sa fin, il s’effondrerait sur les ailes des merveilleux accords de Wagner.
Dès sa plus petite enfance Helen Traubel a toujours été amoureuse des sons elle avait toujours senti qu’ils étaient l’origine primitive de la musique. Les coassements des grenouilles qu’elle pouvait entendre depuis la dernière maison de son existence étaient la chose qui la ravissait le plus au monde. Petite fille, son père, qui mourut quand elle avait douze ans, l’amenait à la chasse aux canards. Il lui assignait pour tâche d’imiter l’appel du canard afin de les attirer. Elle était enchantée d’avoir l’opportunité de reproduire une nouvelle sorte de bruit. Elle passait des heures tous les jours, à la saison de la chasse aux canards, à s’exercer. Dans son lit, la nuit, elle reproduisait leurs différents appels, la colère, l’apaisement, l’indifférence, l’amour, toute la gamme du royaume des canards. Les voisins n’appréciaient pas. Ils sautaient de leur lit, ouvrait la fenêtre et criaient : « Otto ! Otto! Empêche ta fille d’imiter ce damné appel du canard ! qu’elle nous laisse dormir. »
A regrets Helen s’arrêtait. Mais bien plus tard elle dut convenir que ce fut le commencement de sa pratique de ses toutes premières vraies notes basses.
Michel Olivié
Les sources de ce texte viennent de témoignages trouvés sur internet dans le fonds de bibliothèques des Etats-Unis, de ce qui est disponible des archives du Metropolitan de New York et de l’autobiographie d’Helen Traubel St Louis Woman, Ed. Duell, Sloan and Pearce, New York 1959.
The Metropolitan Opera Murders Ed Avon Books New York 1951